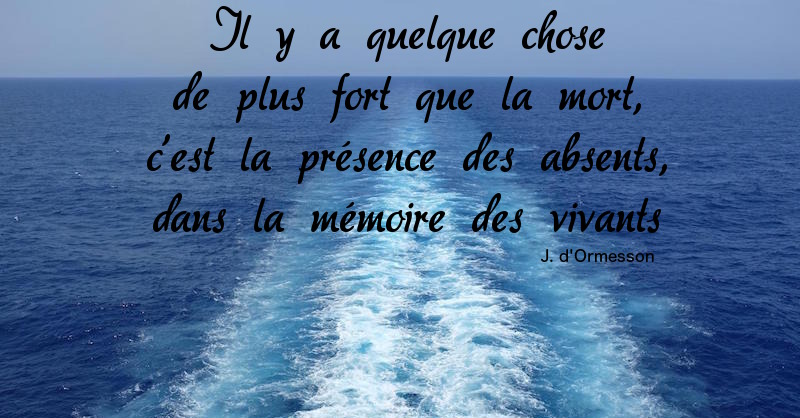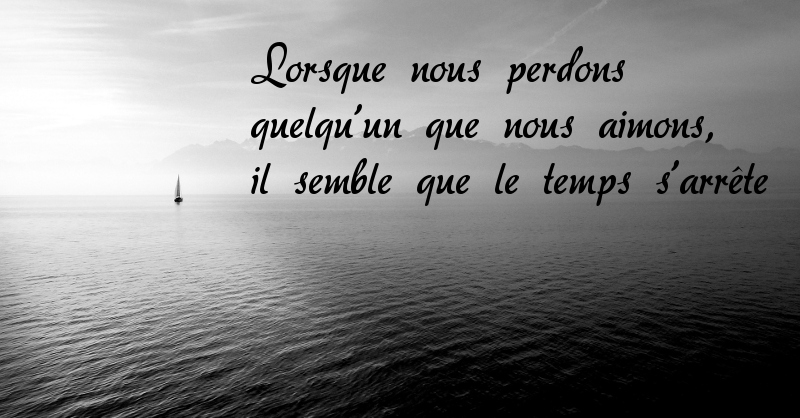I.
On ne songe à la Mort que dans son voisinage :
Au sépulcre éloquent d’un être qui m’est cher,
J’ai, pour m’en pénétrer, fait un pèlerinage,
Et je pèse aujourd’hui ma tristesse d’hier.
Je veux, à mon retour de cette sombre place
Où semblait m’envahir la funèbre torpeur,
Je veux me recueillir et contempler en face
La mort, la grande mort, sans défi, mais sans peur.
Assiste ma pensée, austère poésie
Qui sacres de beauté ce qu’on a bien senti ;
Ta sévère caresse aux pleurs vrais s’associe,
Et tu sais que mon cœur ne t’a jamais menti.
Si ton charme n’est point un misérable leurre,
Ton art un jeu servile, un vain culte sans foi,
Ne m’abandonne pas précisément à l’heure
Où, pour ne pas sombrer, j’ai tant besoin de toi.
Devant l’atroce énigme où la raison succombe,
Si la mienne fléchit tu la relèveras ;
Fais-moi donc explorer l’infini d’outre-tombe
Sur ta grande poitrine entre tes puissants bras ;
Fais taire l’envieux qui t’appelle frivole,
Toi qui dans l’inconnu fais crier des échos
Et prêtes par l’accent, plus sûr que la parole,
Un sens révélateur au seul frisson des mots.
Ne crains pas qu’au tombeau la morte s’en offense,
Ô poésie, ô toi, mon naturel secours,
Ma seconde berceuse au sortir de l’enfance,
Qui seras la dernière au dernier de mes jours.
II.
Hélas ! J’ai trop songé sous les blêmes ténèbres
Où les astres ne sont que des bûchers lointains,
Pour croire qu’échappé de ses voiles funèbres
L’homme s’envole et monte à de plus beaux matins ;
J’ai trop vu sans raison pâtir les créatures
Pour croire qu’il existe au delà d’ici-bas
Quelque plaisir sans pleurs, quelque amour sans tortures,
Quelque être ayant pris forme et qui ne souffre pas.
Toute forme est sur terre un vase de souffrances,
Qui, s’usant à s’emplir, se brise au moindre heurt ;
Apparence mobile entre mille apparences
Toute vie est sur terre un flot qui roule et meurt.
N’es-tu plus qu’une chose au vague aspect de femme,
N’es-tu plus rien ? Je cherche à croire sans effroi
Que, ta vie et ta chair ayant rompu leur trame,
Aujourd’hui, morte aimée, il n’est plus rien de toi.
Je ne puis, je subis des preuves que j’ignore.
S’il ne restait plus rien pour m’entendre en ce lieu,
Même après mainte année y reviendrais-je encore,
Répéter au néant un inutile adieu ?
Serais-je épouvanté de te laisser sous terre ?
Et navré de partir, sans pouvoir t’assister
Dans la nuit formidable où tu gis solitaire,
Penserais-je à fleurir l’ombre où tu dois rester ?
III.
Pourtant je ne sais rien, rien, pas même ton âge :
Mes jours font suite au jour de ton dernier soupir,
Les tiens n’ont-ils pas fait quelque immense passage
Du temps qui court au temps qui n’a plus à courir ?
Ont-ils joint leur durée à l’ancienne durée ?
Pour toi s’enchaînent-ils aux ans chez nous vécus ?
Ou dois-tu quelque part, immuable et sacrée,
Dans l’absolu survivre à ta chair qui n’est plus ?
Certes, dans ma pensée, aux autres invisible,
Ton image demeure impossible à ternir,
Où t’évoque mon cœur tu luis incorruptible,
Mais serais-tu sans moi, hors de mon souvenir ?
Servant de sanctuaire à l’ombre de ta vie,
Je la préserve encor de périr en entier.
Mais que suis-je ? Et demain quand je t’aurai suivie,
Quel ami me promet de ne pas t’oublier ?
Depuis longtemps ta forme est en proie à la terre,
Et jusque dans les cœurs elle meurt par lambeaux,
J’en voudrais découvrir le vrai dépositaire,
Plus sûr que tous les cœurs et que tous les tombeaux.
IV.
Les mains, dans l’agonie, écartent quelque chose.
Est-ce aux mots d’ici-bas l’impatient adieu
Du mourant qui pressent sa lente apothéose ?
Ou l’horreur d’un calice imposé par un dieu ?
Est-ce l’élan qu’imprime au corps l’âme envolée ?
Ou contre le néant un héroïque effort ?
Ou le jeu machinal de l’aiguille affolée,
Quand le balancier tombe, oublié du ressort ?
Naguère ce problème où mon doute s’enfonce,
Ne semblait pas m’atteindre assez pour m’offenser ;
J’interrogeais de loin, sans craindre la réponse,
Maintenant je tiens plus à savoir qu’à penser.
Ah ! Doctrines sans nombre où l’été de mon âge
Au vent froid du discours s’est flétri sans mûrir,
De mes veilles sans fruit réparez le dommage,
Prouvez-moi que la morte ailleurs doit refleurir,
Ou bien qu’anéantie, à l’abri de l’épreuve,
Elle n’a plus jamais de calvaire à gravir,
Ou que, la même encor sous une forme neuve,
Vers la plus haute étoile elle se sent ravir !
Faites-moi croire enfin dans le néant ou l’être,
Pour elle et tous les morts que d’autres ont aimés,
Ayez pitié de moi, car j’ai faim de connaître,
Mais vous n’enseignez rien, verbes inanimés !
Ni vous, dogmes cruels, insensés que vous êtes,
Qui du juif magnanime avez couvert la voix ;
Ni toi, qui n’es qu’un bruit pour les cerveaux honnêtes,
Vaine philosophie où tout sombre à la fois ;
Toi non plus, qui sur Dieu résignée à te taire
Changes la vision pour le tâtonnement,
Science, qui partout te heurtant au mystère
Et n’osant l’affronter, l’ajournes seulement.
Des mots ! Des mots ! Pour l’un la vie est un prodige,
Pour l’autre un phénomène. Eh ! Que m’importe à moi !
Nécessaire ou créé je réclame, vous dis-je,
Et vous les ignorez, ma cause et mon pourquoi.
V.
Puisque je n’ai pas pu, disciple de tant d’autres,
Apprendre ton vrai sort, ô morte que j’aimais,
Arrière les savants, les docteurs, les apôtres.
Je n’interroge plus, je subis désormais.
Quand la nature en nous mit ce qu’on nomme l’âme,
Elle a contre elle-même armé son propre enfant ;
L’esprit qu’elle a fait juste au nom du droit la blâme,
Le cœur qu’elle a fait haut la méprise en rêvant.
Avec elle longtemps, de toute ma pensée
Et de tout mon cœur, j’ai lutté corps à corps,
Mais sur son œuvre inique, et pour l’homme insensée,
Mon front et ma poitrine ont brisé leurs efforts.
Sa loi qui par le meurtre a fait le choix des races,
Abominable excuse au carnage que font
Des peuples malheureux les nations voraces,
De tout aveugle espoir m’a vidé l’âme à fond ;
Je succombe épuisé, comme en pleine bataille
Un soldat, par la veille et la marche affaibli,
Sans vaincre, ni mourir d’une héroïque entaille,
Laisse en lui les clairons s’éteindre dans l’oubli ;
Pourtant sa cause est belle, et si doux est d’y croire
Qu’il cherche en sommeillant la vigueur qui l’a fui ;
Mais trop las pour frapper, il lègue la victoire
Aux fermes compagnons qu’il sent passer sur lui.
Ah ! Qui que vous soyez, vous qui m’avez fait naître,
Qu’on vous nomme hasard, force, matière ou dieux,
Accomplissez en moi, qui n’en suis pas le maître,
Les destins sans refuge, aussi vains qu’odieux.
Faites, faites de moi tout ce que bon vous semble,
Ouvriers inconnus de l’infini malheur,
Je viens de vous maudire, et voyez si je tremble,
Prenez ou me laissez mon souffle et ma chaleur !
Et si je dois fournir aux avides racines
De quoi changer mon être en mille êtres divers,
Dans l’éternel retour des fins aux origines,
Je m’abandonne en proie aux lois de l’univers.