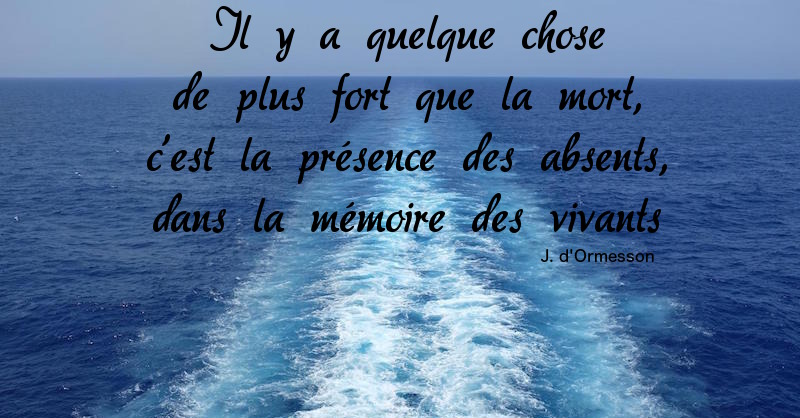Mère, voilà douze ans que notre fille est morte ;
et depuis, moi le père et vous la femme forte,
nous n’avons pas été, Dieu le sait, un seul jour
sans parfumer son nom de prière et d’amour.
Nous avons pris la sombre et charmante habitude
de voir son ombre vivre en notre solitude,
de la sentir passer et de l’entendre errer,
et nous sommes restés à genoux à pleurer.
Nous avons persisté dans cette douleur douce,
et nous vivons penchés sur ce cher nid de mousse
emporté dans l’orage avec les deux oiseaux.
Mère, nous n’avons pas plié, quoique roseaux
ni perdu la bonté vis-à-vis l’un de l’autre,
ni demandé la fin de mon deuil et du vôtre
à cette lâcheté qu’on appelle l’oubli.
Oui, depuis ce jour triste où pour nous ont pâli
les cieux, les champs, les fleurs, l’étoile, l’aube pure,
et toutes les splendeurs de la sombre nature,
avec les trois enfants qui nous restent, trésor
de courage et d’amour que Dieu nous laisse encor,
nous avons essuyé des fortunes diverses,
ce qu’on nomme malheur, adversité, traverses,
sans trembler, sans fléchir, sans haïr les écueils,
donnant au deuil du cœur, à l’absence, aux cercueils,
aux souffrances dont saigne ou l’âme ou la famille,
aux êtres chers enfuis ou morts, à notre fille,
aux vieux parents reprise par un monde meilleur,
nos pleurs, et le sourire à toute autre douleur.
Victor Hugo