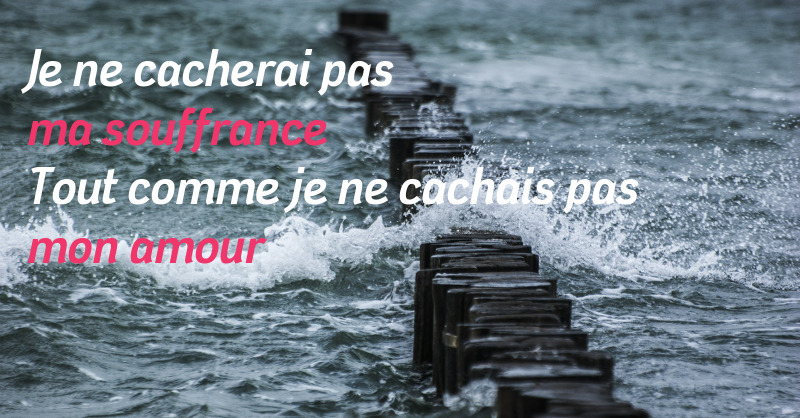À Madame Sureau-Bellet.
I.
L’hirondelle frileuse au loin s’était enfuie.
Sous les dernières fleurs, les papillons mouraient.
Près des étangs voilés où crépitait la pluie,
Sur des eaux sans miroir les grands saules pleuraient.
Dans la nature en deuil plus d’oiseau, plus d’abeille.
Son fagot sur l’épaule et les deux mains en croix,
Au bord de la forêt une petite vieille
Marchait avec lenteur en emportant son bois.
C’était Marthe la veuve, au pays bien connue,
Fille et femme autrefois de simples bûcherons,
Depuis longtemps couchés en terre froide et nue,
Où tous, jeunes et vieux, tôt ou tard nous irons.
Son homme, un gars robuste, allant à la hêtraie,
Ne revint pas un soir qu’on l’avait attendu.
L’arbre qu’il abattait sous la haute futaie
Tombait en étouffant son dernier cri perdu.
Et plus tard ses deux fils (elle n’y croyait guère)
Partaient l’un après l’autre, et quittant leurs sabots,
Pour de lointains pays où la France est en guerre,
S’embarquaient, emportés sur de longs paquebots.
Partout où le drapeau fièrement se déploie,
Et les premiers au feu des plus rudes combats,
Lisant un nom sacré sur un lambeau de soie,
Tous deux, morts côte à côte, étaient restés là-bas.
Mais ils reposaient loin de leur forêt bénie,
Sous les ardents soleils où sont les tamarins,
Oubliés vite, après la bataille finie,
Dans les roseaux d’un fleuve ou les sables marins.
II.
« Pensez-vous quelquefois aux mères de famille, »
Me dit la femme en deuil… Mes larmes pour eux trois
Tombaient sur le berceau d »une petite fille,
Vive et joyeuse alors comme un oiseau des bois.
« Elle est trop jeune encore… Il faudra que j’attende…
(La mort jusqu’à présent n’a pas voulu de moi).
Je m’en irai plus tard, quand elle sera grande.
Dieu m’a permis de vivre, il a bien su pourquoi. »